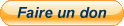« Une femme étincelante et timide », par Marguerite Yourcenar

Marguerite Yourcenar
En Pèlerin, en étranger
Une femme étincelante et timide
« Quand je naquis, une étoile dansait », dit une héroïne de Shakespeare. Il faut toujours en revenir à Shakespeare quand il s’agit des Anglaises. Si l’on s’arrête à considérer la profondeur scintillante de l’œuvre de Mrs. Woolf, sa légèreté rivée à on ne sait quel ciel abstrait, les pulsations glacées d’un style qui fait penser tour à tour à ce qui traverse et à ce qui est traversé, à la lumière et au cristal, on en vient à se dire que cette femme si subtilement singulière naquit peut-être à la minute précise où une étoile se prenait à penser. Sans doute, ces vertus magiques et quelque peu froides des astres tiennent en partie à la distance où nous nous trouvons d’eux : il suffit d’approcher ces brillants solitaires pour s’apercevoir que leur lueur est aussi une flamme, et qu’ils ne rayonnent qu’à condition de se laisser consumer. Les quelques pages qui vont suivre auront atteint leur but si je parviens à persuader le lecteur de l’intense sentiment d’humanité qui se dégage d’une œuvre où il est permis de ne voir d’abord qu’un ballet admirable que l’imagination offre à l’intelligence.
Fille de l’éminent critique Stephen Leslie, issue d’une famille où plane le grand souvenir de Thackeray, fière aussi d’une goutte de sang français qui lui vient d’une aïeule émigrée au cours de la Révolution, cette femme aux clairs yeux bleus, aux imposants cheveux blancs qui évoquent involontairement toutes les comparaisons à qui elle seule pourrait rendre de la fraîcheur, le givre, l’argent, et l’auréole, a donc vu se pencher sur son berceau toutes les fées de la littérature anglaise : énumérons-les, ces fées mineures qui ne suffisent pas à déterminer le génie, mais s’offrent fidèlement à lui servir de guide dans les passes difficiles : c’est d’abord le sens amical de la vie journalière, qui fit si importants les romanciers de l’Angleterre victorienne ; c’est ensuite cette érudition aisée, aussi aérée que possible, qui donne souvent aux grands essayistes de l’Angleterre l’air de se promener à l’intérieur des chefs-d’œuvre, aussi à l’aise dans leur savoir que les touristes anglais vêtus de flanelle grise sous les colonnes du Parthénon. Enfin, n’oublions pas le dernier don des fées bienveillantes, venu peut-être plus spécialement de la France et du XVIII e siècle auxquels elle se rattache par de vagues et beaux liens : le sens de l’harmonie des proportions, et la lucidité jusque dans la grâce.
Si riches qu’ils soient, ces dons ne suffisent pas à la dot d’un poète : il en est un autre, plus mystérieux, celui de transfigurer la réalité, ou de faire tomber ses masques. La petite fille qui regardait dans la brume du soir anglais les bateaux de pêche regagner le port savait déjà, comme cette Rhoda de Vagues pour laquelle elle a utilisé ses souvenirs, que les voiles des barques au coucher du soleil sont autant de pétales de fleurs, et que les pétales de fleurs emportés à la surface d’un ruisseau par un jour d’orage sont très authentiquement des barques.
(...)
Vagues est un livre à six personnages, à six instruments plutôt, car il consiste uniquement en longs monologues intérieurs dont les courbes se succèdent, s’entrecroisent, avec une sûreté de dessin qui n’est pas sans rappeler l’Art de la fugue . Dans ce récit musical, les brèves pensées de l’enfance, les rapides réflexions des moments de jeunesse et de camaraderie confiante tiennent lieu des allégros dans les symphonies de Mozart, et cèdent de plus en plus la place aux lents andantes des immenses soliloques sur l’expérience, la solitude, et l’âge mûr.
Vagues en effet, autant qu’une méditation sur la vie, se présente comme un essai sur l’isolement humain. Il s’agit de six enfants, trois filles, Rhoda, Jinny, Suzanne, trois garçons, Louis, Neville et Bernard, que nous voyons croître, se différencier, vivre, et vieillir enfin. Un septième enfant, qui ne prend pas la parole, et que nous n’apercevons jamais qu’à travers les autres, est le centre du livre, ou plutôt son cœur.
Ce Perceval, entouré au collège et sur les terrains de jeux d’un amour et d’une admiration enfantine, part rejoindre son régiment aux Indes, et les six jeunes amis de se réunir autour de lui pour un dîner d’adieu. Puis, on apprend sa mort, survenue là-bas à la suite d’une chute de cheval, et nous voyons réagir différemment devant la douleur ces six êtres pour qui Perceval restera à jamais l’image des moments les plus ensoleillés de la vie. Chacun donnera désormais aux questions que lui pose sa propre existence une réponse de plus en plus personnelle : Jinny choisira le plaisir, Neville l’exercice de l’intelligence et la recherche ardente d’autres êtres qui seront autant de reflets de Perceval perdu ; Suzanne, la jeune Déméter, trouvera la plénitude dans les lentes besognes de la maternité et dans le contact quotidien de la terre et des saisons ; Rhoda et Louis se réfugieront dans leurs songes ; Bernard continuera à dévider paresseusement, à la façon d’un ver à soie, le cocon de sensations et de pensées qui lui sert à ouater son univers ; et enfin, un soir, nous retrouverons ce même Bernard alourdi par l’âge et le bien-être, qui sort d’un restaurant en réfléchissant à sa vie.
Il sent autour de lui l’approche de la Mort, qui bien des années plus tôt, dans l’Inde, a désarçonné Perceval, et l’a jeté sur le sol où il s’est brisé. Mais dans l’exaltation de son cœur encore chaud, ce vieux Monsieur un peu ridicule accepte de se mesurer avec cette ennemie invisible, et lui jette un défi. La Mort peut venir ; elle n’empêchera pas que ce vivant ne se sente jusqu’au bout partie liée avec la vie ; anéanti, il ne sera pas tout à fait vaincu. Il ne s’agit pas d’un triomphe de l’immortalité sur la mort, mais plutôt d’un sentiment intense du moment actuellement vécu. Le Temps, qui prend désormais pour Bernard cette forme définitive et funèbre, est vaincu à l’aide d’une succession d’instants dont la richesse et l’ardeur constituent quoi qu’il arrive son acquis humain.
On peut certes faire ses réserves devant cet univers romanesque d’où toute violence, toutes poussées instinctives, toute volonté qui n’est pas qu’intellectuelle sont exclues, mais ces reproches aboutissent à réclamer de Turner la fougue de Delacroix, et à s’étonner de l’absence de tableaux de bataille dans l’œuvre de Chardin. Les personnages de Vagues ne sont pas moins humains dans leur délicatesse presque translucide que les ardents obsédés de Lawrence ou les héros grossiers et pathétiques de l’Ulysse de Joyce : ils ne sont que plus rares, moins envahissants, et rassurés comme malgré eux par les minutes de contemplation quasi mystique que Virginia Woolf leur accorde, et qui maintiennent cette œuvre pourtant si désabusée en deçà de la mort et du néant.
Dans Vagues , l’admirable coloration des natures mortes et des paysages rappelle certaine peinture moderne, mais avec une poésie secrète, une profondeur de sérénité, un sens magique de l’enchantement des choses apparenté plutôt à l’œuvre de Vermeer, si chère aussi à Marcel Proust, dont le style évoquerait cependant davantage les procédés de Degas. Ce charme presque idyllique de la couleur se relie souvent chez les peintres au souci des valeurs mystiques, et trahit le même goût des vibrations uniques, des minutes éternelles dont nous avons vu plus haut que le monde de Virginia Woolf était fait. Peut-être faut-il recourir ici à la dernière phrase que prononce à la fin de La Promenade au phare la pauvre Miss Briscoë, dont la terne existence s’est usée à peindre d’assez médiocres toiles qu’elle ne parvient jamais à finir :
« Après tout, murmure-t-elle, en pensant à sa vie si triste et cependant si peu déçue, après tout, j’ai eu ma vision »
Ce mot va rejoindre sur un mode moins épique le dernier monologue de Bernard dans Vagues. Comme dans Le Temps retrouvé, mais sans mettre l’accent sur la résurrection du passé, comme dans les Cahiers de Rilke où l’angoisse humaine s’apaise dans la paisible contemplation des choses, les personnages un peu falots de la romancière anglaise trouvent dans ces brefs instants de perception de la vie et d’identification avec elle cette justification de l’existence aussi nécessaire que le pain et le soleil. Cette pensée toute mystique de l’humble Miss Lily peut servir de conclusion à l’œuvre de Virginia Woolf, et il est étrangement significatif que ce soit une vue de peintre.
Il y a peu de jours, dans le salon vaguement éclairé par les lueurs du feu où Mrs. Woolf avait bien voulu m’accueillir, je regardais se profiler sur la pénombre ce pâle visage de jeune Parque à peine vieillie, mais délicatement marquée des signes de la pensée et de la lassitude, et je me disais que le reproche d’intellectualisme est souvent adressé aux natures les plus fines, les plus ardemment vivantes, obligées obligées par leur fragilité ou par leur excès de forces à recourir sans cesse aux dures disciplines de l’esprit. Pour de tels êtres, l’intelligence n’est qu’une vitre parfaitement transparente derrière laquelle ils regardent attentivement passer la vie.
Et tandis que Virginia Woolf, dirigeant la conversation sur l’état présent du monde, voulait bien me faire part de ses inquiétudes et de ses tourments, qui sont les nôtres, et où la littérature ne tenait qu’une petite place, je pensais tout bas que rien n’est complètement perdu tant que d’admirables ouvriers continuent patiemment pour notre joie leur tapisserie pleine de fleurs et d’oiseaux, sans jamais mêler indiscrètement à leur œuvre l’exposé de leurs fatigues, et le secret des sucs souvent douloureux où leurs belles laines ont été trempées.
1937