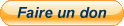"Paroles à un jeune poète", par Jules Bois (1910)
Dernière mise à jour : il y a 5 jours
"Ne chante que ce que tu sens, n'écris que ce que tu penses. La poésie ne vaut que par l'émotion véridique, ressentie et donnée. Le reste est vain, le reste est de l'encombrement et du verbiage. Il est plusieurs poètes qu'un seul poème, parce qu'il était sincèrement inspiré, a rendus immortels."

Jules Bois
(Coll. pers.)
Paroles à un jeune poète
Jules Bois, texte introductif au recueil poétique L'Humanité divine, 1910.
I
Tu viens quelquefois me voir ; et tous deux, nous nous accoudons à ma terrasse, où monte comme un bouquet l'odeur printanière du Bois. Cet horizon presque sans limite et parisien pourtant se dilate de toute l'immensité du ciel ; et les maisons des hommes ne gâtent pas la nature, étant embellies au loin par la brume ou le soleil. Alors nous parlons de tes rêves, de tes projets, des destins de cette poésie française qui vient de traverser une crise redoutable.
Perverse avec Baudelaire, trouble et troublante avec Verlaine, sensuelle avec Mendès, funambulesque avec Banville, révoltée et néantiste avec Leconte de Lisle, la poésie contemporaine était peu à peu détachée de l'idéal et détournée de la pensée. Au lieu de suivre les traces lumineuses de Sully Prudhomme et de Vigny, elle se diluait dans les crépuscules compliqués de l'école symboliste et décadente. Enfin, après bien des secousses et des sursauts, la voilà devenue saine, bourgeoise, croyante, familiale et rustique. Ceux d'entre nous, qui ont à examiner les œuvres de tes camarades pour les différents prix à leur accorder, sont étonnés de voir tant de strophes consacrées à célébrer le père, la mère, l'épouse, l'enfant, la maison et même le banc du jardin, qui généralement est petit. La mère surtout ; les poètes d'aujourd'hui sont très « filiaux ».
Quel chemin parcouru depuis Les Fleurs du Mal où, au milieu de tant de pièces admirables qui célèbrent des passions trop étranges, éclatent ces strophes où la mère du poète maudit son fils comme un monstre, parce qu'elle ne le comprend pas !...
Sa mère, épouvantée et pleine de blasphèmes !
Crispe ses poings vers Dieu qui la prend en pitié.
Et l'enfant de « ce siècle appauvri », volontiers blasphémateur, entend « la lune offensée » lui dire qu'elle voit sa mère,
Qui vers son miroir penche un lourd amas d'années
Et plâtre artistement le sein qui l'a nourri !
Autrefois, en effet, — quand je dis autrefois, il n'y a pas très longtemps, — les braves gens étaient effrayés d'avoir couvé ce « canard sauvage », qu'on appelle un poète. C'était presque la ruine et parfois le déshonneur de la famille. Aujourd'hui, les enfants des bourgeois riment à outrance, garçons et filles ; ce qui est une nouveauté de plus, due au féminisme encore inconnu aux temps baudelairiens. Maints parents sont très fiers d'avoir mis au monde un poète ou une poétesse ; ils paient volontiers l'édition du premier volume et même du second. Les succès d'argent de tels aînés célèbres firent beaucoup pour réconcilier la poule couveuse et le coq de basse-cour avec le petit canard sauvage. Notre démocratie, d'autre part, se flattant d'être athénienne, a encouragé les poètes par des rubans violets et rouges, des sinécures et même des sommes d'argent. Versifier est devenu à peu près une carrière. Il était donc naturel que le titre du poète se modifiât avec la poésie et d'accord avec elle. L'ancien bohème aux longs cheveux, au gosier toujours sec, aux poches vides et aux mœurs errantes, a été remplacé par un monsieur comme toi, considéré de sa concierge, vêtu sobrement, circonspect et diplomate, travaillant à des heures fixes, adoptant une hygiène, sachant tenir ses comptes et régler sa vie.
Tu as un emploi, tu dédaignes la fréquentation des brasseries, tu devais en arriver là où aboutissent à peu près tous les travailleurs de l'heure présente, tu fais partie d'un syndicat — oui, d'un syndicat de poètes...
Cessons d'ironiser et passons à des réalités plus graves. Avec les meilleurs de ta génération, tu es revenu aux traditions de notre langue et de notre esprit. Tu as répudié l'extraordinaire, l'obscur, le malsain. Tu as aussi reconnu la logique, la solidité de cette prosodie que l'assentiment populaire, autant que les grands artistes tes devanciers, a fixée ; elle ne se modifie que lentement, non pas selon de brusques caprices, mais par des besoins profonds. L'essai du « verslibrisme » révolutionnaire n'a pas été en soi un échec comme on a pu le croire. La poésie s'est enrichie d'un moyen nouveau d'expression, qui tient du vers et de la prose. Mais il eût été insensé que cette acquisition récente et encore inorganique voulût se substituer au legs des siècles que consacrèrent tant de chefs-d'œuvre.
Tu m'as approuvé lorsque je t'ai exposé l'opinion que nous nous sommes formée après réflexion et au contact de l'expérience. Je tiens à la préciser ici :
Loin de s'affranchir des difficultés prosodiques, le poète ne doit pas les craindre. Il ne doit pas non plus les rechercher, de peur de tomber dans le puérilisme et la jonglerie. Cependant, il n'est pas douteux que l'idée gagne en beauté à accepter des règles sévères et logiques, qui obligent à ne pas improviser et à poursuivre la perfection. Notre prosodie de l'heure présente s'affine, plus délicate, plus sensible au frisson intérieur qu'elle traduit avec une exactitude accrue. Au lieu d'évoluer vers le relâchement, elle s'achemine vers un art de plus en plus conscient et complexe. Écoutez sonner le beau vers moderne. C'est une musique orchestrée savamment. La césure est moins monotone, mieux adaptée au mouvement. La rime n'est plus nécessairement et inutilement riche ou baroque comme chez Hugo et Banville, ni nécessairement et négligemment pauvre comme chez Racine et Musset. Elle se surveille, s'épure, évite l'adjectif, la redite, la banalité autant que le charlatanisme. Un esclavage ? non ; je crois plutôt une coquetterie. Certaines lois loyalement subies sont-elles tout à coup abrogées ? C'est par un scrupule aux antipodes de la paresse, c'est pour un effet prémédité, résultat d'une difficulté supérieure vaincue... Ainsi plus la métrique est intelligente et méticuleuse, plus le vers est en droit d'espérer l'immortalité.
« Tant pis, m'as-tu dit avec l'intransigeance de la jeunesse, tant pis pour ceux et pour celles qui ont rimé et rythmé détestablement des émotions intéressantes ; nous rejetterons tout cela au chaos oublié des vers faux. »
C'est aller sans doute trop loin... mais il est incontestable que seule est certaine de survivre l'œuvre sans bavures. Il est heureux que la jeunesse se soit ressaisie et que l'anarchie sur ce point ait cessé.
Nous sommes à peu près d'accord prosodiquement.
Quant à l'inspiration et à sa mise en œuvre, je veux en discuter avec toi. Un poète français est quelque chose de plus qu'un poète national : il est un poète humain. Je te jure que ta lampe, ta chambre, ta rivière, ta campagne, ta ville, ta famille, que tu célèbres avec fidélité, ne nous intéressent que faiblement, si tu ne sais pas en faire les sujets d'un rêve plus étendu, où le reste de l'humanité se retrouve. L'intimisme et le naturisme ne valent que s'ils sortent de l'anecdote et ne sont pas prisonniers de l'horizon. Approfondis, élargis ton âme par le travail, le voyage, la méditation, l'amour. Mais n'imite pas ceux de tes devanciers qui, avec beaucoup de talent, ne furent que des rhétoriciens et des jongleurs. Dédaigne l'amplification. Ne chante que ce que tu sens, n'écris que ce que tu penses. La poésie ne vaut que par l'émotion véridique, ressentie et donnée. Le reste est vain, le reste est de l'encombrement et du verbiage. Il est plusieurs poètes qu'un seul poème, parce qu'il était sincèrement inspiré, a rendus immortels...
II
Je te parle comme un voyageur qui a déjà parcouru le pays à un de ses amis qui en est aux préparatifs du départ. J'en reviens avec une moisson cueillie souvent sous l'orage et la tempête et dans les contrées les plus diverses. C'est l'histoire d'une jeunesse qui, au lieu de se restreindre aux études et aux émotions souvent artificielles et superficielles que l'ambiance commande, a voulu aller plus loin et plus au fond, jusqu'à explorer l'au-delà réel de la matière et de l'esprit.
Or, si j'en crois le plus pur de nos inspirés, cet attrait et cette recherche ne seraient pas contradictoires à l'essence même de la poésie et à sa mission que rebutent au contraire les vulgarités, les redites, les petitesses.
Lamartine, il y a près d'un siècle, définissait déjà la poésie « l'écho profond, réel, sincère des plus hautes conceptions de l'intelligence, des plus mystérieuses impressions de l'âme ».
Et il ajoutait :
« Ce sera l'homme lui-même et non plus son image, l'homme sincère et tout entier. »
L'humanité intégrale comporte ce noble désir, cette aspiration élevée, cette foi intime, par lesquels, sans nous y perdre, nous atteignons le Divin dont nous avons soif, même dans le détresse et dans la déchéance.
On raconte qu'un grand spiritualiste, Herder, prononça ce mot admirable à son lit de mort :
« Donnez-moi une grande pensée pour me rafraîchir. »
Tous, ainsi que Herder, nous pouvons pousser ce cri sans attendre l'agonie. Tous, nous défaillons au cours de l'existence, réduits à nous-mêmes. Que nous sommes peu de chose dans ce vaste univers, où nous guettent les forces hostiles, dont les plus redoutables nous habitent et nous tourmentent ! Mais un petit souffle effleure notre front; caresse d'un véridique amour, strophe ressouvenue d'un poète préféré, maxime d'un sage, exemple d'héroïsme, larme qui, en tombant, fait éclore une consolation... Et nous voilà réconfortés. Un dieu a passé sur notre route et il a éveillé dans notre cerveau et dans notre cœur la présence incompréhensible d'un autre dieu... Ce mystère de la faiblesse humaine, je l'ai médité sous mille aspects ; et je n'ai jamais désespéré parce qu'il nous prépare à un autre mystère, celui de notre grandeur et de notre gloire... L'orgueil est vaincu, mais la confiance demeure.
Dès lors la question se pose : qu'est-ce que ce Divin qui semble n'apparaître que dans une humanité plus humaine et plus profonde ?
Ernest Renan, ce Goethe plus conciliant, avait coutume de dire, dans ses conversations d'après dîner : « Dieu, je ne peux pas affirmer qu'il soit, mais je ne doute pas du Divin. » Ce grand sceptique ne croyait pas formuler un des axiomes de cette foi nouvelle qui a succédé au renanisme. Le Divin, en effet, on peut dire que c'est Dieu, au deuxième degré, mais Dieu encore, Dieu humanisé qui se révèle à nous par toute une série d'émotions, de sentiments, de pensées, plus nobles et plus beaux, jaillis des entrailles de notre être. Le Divin ne serait-ce pas encore Dieu pour ainsi dire « naturalisé » et transparent dans ces admirables spectacles que nous prodigue l'univers, soit spontané, soit embelli par les chefs-d'œuvre dûs à la main des hommes? Comment traiter d'imaginations ces témoignages intimes confirmés par la beauté des choses? Quand même on s'obstinerait à nous affirmer contre toute raison que ce monde magnifique, entrevu autour de nous et en nous, n'est qu'une illusion, et — je suppose admise cette hypothèse impossible à admettre — quand même le ciel espéré n'existerait que dans notre désir, toutes les ironies et tous les positivismes voileraient à peine ces lueurs sans pouvoir jamais les éteindre. Ce sont des faits, des faits intérieurs, des faits extérieurs aussi, et dès lors, pour notre âme et pour l'âme de l'univers, des réalités invincibles.
D'ailleurs comment pourrait-il en être autrement? .
Si l'humanité n'était pas divine, et si la divinité n'était pas humaine, nous tomberions dans le plus dangereux mysticisme ou dans le matérialisme le plus abject. Nous nous perdones dans la chimère et dans l'absurdité, en voulant chercher le Divin en dehors de la nature et de l'homme. D'autre part, l'humanité, décapitée du Divin, ne vaut pas la peine d'être chantée, elle n'est qu'un spectacle souvent vil et presque toujours attristant. En prose aussi, lorsque fait défaut cette attirance à la fois respectueuse et angoissée vers les cimes, il n'est que des talents incomplets et des génies sans ailes.
Nous n'aurions que cette preuve par l'exemple, qu'il nous faudrait déjà placer parmi les genres secondaires toute littérature, même supérieure par l'art et le style, mais à qui manquerait le sens hyperphysique, c'est-à-dire la vraie poésie. Les pages « humaines » entièrement belles sont illuminées de « surhumain », comme il y a un souffle qui ne vient plus de ce monde dans un simple dialogue d'amour, le soir, lorsque les étoiles s'allument dans le ciel, lampes lointaines d'une patrie inconnue...
Nous chanterons l'univers et notre âme jusqu'à être transportés au-dessus de nous-mêmes et de tout ce qui nous entoure...
III
Ces paroles familières que nous échangeons, je souhaite qu'elles aident à dissiper les derniers brouillards qui traînent sur la voie que Lamartine, le chaste prophète, a tracée. Cette voie n'a pas été immédiatement suivie, parce que le prodigieux génie verbal de Victor Hugo a ébloui et tyrannisé les lyriques du siècle passé. Aujourd'hui seulement, ce soleil se faisant de plus en plus lointain, il nous est permis de reprendre la route abandonnée, la route idéistique et musicale, où nous précéda Lamartine. Nous allons nous rendre compte qu'entre l'humain et le divin, la nature et le surnaturel, il n'est pas de différences essentielles, simplement une gradation et des nuances. Toutes les forces de l'époque tendent à établir comme un fait authentique cette vérité de l'esprit et du cœur. Elle se formule en la renaissance de l'idéal hellénique sous une forme nouvelle et par des moyens encore inusités.
L'Amérique, d'autre part, le pays pratique par excellence, nous indique comment comprendre et, si j'ose dire, adapter à notre vie quotidienne ce frisson qui la dépasse, et comment en tirer des ressources imprévues. Un seul danger : la confusion entre le surhomme tel que nous le concevons, nous Latins, et celui qu'inventa le sophisme allemand, monstre de domination brutale et d'égoïsme. Mais il suffit de préciser ce danger pour qu'il se dissipe.
Enfin, ces idées ne renouvellent pas seulement le domaine théorique et spéculatif ; elles sont des principes d'énergie généreuse et féconde. Ainsi, le poète et le héros se rejoignent par de secrètes affinités. Ce que l'un chante, l'autre l'accomplit. Et ils n'existeraient pas l'un sans l'autre : et quelquefois tous deux ne font qu'un.
Excuse-moi de te proposer de telles méditations à l'occasion d'une œuvre personnelle. Il y a quelque chose de meilleur que l'exemple que nous donnons : c'est le modèle qui nous a inspirés. En tracer l'image est un impérieux devoir, puisqu'il s'agit de conseiller à des jeunes gens comme toi de faire mieux que nous.
C'est notre excuse pour avoir gardé en classant ces feuillets épars, ce titre trop beau qui s'est imposé à nous : L'Humanité divine. Ce n'est pas que nous puissions nous illusionner sur nos misères inévitables, mais ces deux mots condensent la pensée en quelque sorte unique qui revenait dans nos conversations, pensée qui résulte aussi, ne serait-ce que par contraste ou par espérance, de ces pages diverses où les luttes et les épreuves, les joies et les errances de toute une jeunesse ont laissé leur reflet. Tu me l'as dit un jour, cette idée, l'Humanité divine, elle doit être tour à tour, pour qui la subit, un fardeau et une ivresse. Un fardeau, parce qu'elle est trop grande et trop austère aux heures de dissipation. Une ivresse, parce qu'aux moments exceptionnels, elle nous exalte et nous transfigure. Tu voyais juste : que de vicissitudes supporte en nous cette divine humanité ! Sur l'Acropole nous en avons eu l'éblouissement, puis peu à peu la précise vision ; aux Indes, nous en avons ressenti le délire ; au mont des Oliviers, nous en goûtâmes la déchirante mélancolie. Jamais nous n'avons cessé d'y croire; cette idée vivante traverse nos autres ouvrages déjà; elle fait partie de notre tempérament; elle a été, au milieu des tempêtes intérieures, le phare immuable qui empêche le navire de s'égarer. Ce n'est ni une illusion ni un mensonge. Quelque chose, ou plutôt quelqu'un de plus grand, de meilleur que nous, parfois nous quitte et parfois nous remplit. Divinité ne ressemblant à aucune des idoles qui encombrent l'univers, Mystère de toute vie humble ou superbe, rayonnement qui prête tant d'éclat aux êtres et aux choses !... Nous vous avons aimé et nous vous aimons, parce que vous êtes avant tout poésie !
IV
Mais la vie contemporaine et occidentale, avec ses rudesses, ses minuties, ses fièvres pratiques, son matérialisme, nous nous le sommes demandé toi et moi, s'accommode-t-elle avec cette « humanité divine » qu'ici tantôt je regrette et tantôt je voudrais évoquer ?
Eh bien, aujourd'hui nous pouvons le croire, nous pouvons même en être sûrs pour des motifs nombreux dont le premier et le plus puissant réside en cette poésie moderne, qui, si longtemps, nous a déçus et qui commence enfin à être digne du rôle qu'elle doit jouer. Je n'y reviendrai que pour une brève synthèse, l'ayant au début plus longuement analysée.
Proclamons-le avec fierté : cette poésie ne renferme plus d'obstacle invincible à un grand espoir. N'as-tu pas d'abord définitivement conquis ta libération esthétique ? Les mauvais maîtres ont disparu. Tu le sais, appartenir à telle ou à telle école a toujours quelque chose de convenu, de puéril et de forcé. Tes vrais directeurs ne sont pas telle ou telle individualité, mais des orientations de sentiment et des tendances de l'esprit. La jonglerie, l'art pour l'art, le système te rebutent. Sur le cosmos poétique se lève l'aube impersonnelle de l'âme émue et pensante.
Pourtant, aucune école n'a été complètement inutile. Le Parnasse, contre lequel nous nous sommes tout d'abord révoltés à cause de la rigidité de ses dogmes et des idées moyennes qu'il exprima, nous a donné l'exemple de cette esthétique sobre et sûre, qui empêcha ses adeptes de s'égarer vers les mirages de la paresse, du dérèglement et du verbiage. Malheureusement cette école manquait d'air : parfois trop de solennité et de raideur ; parfois trop d'acrobatie. Enfin, les symbolistes se préoccupèrent d'infuser à la métrique plus de souplesse, aux idées plus de recul, aux sentiments plus d'enveloppé et de mystérieux. De nos jours, les poètes chantent, avec beaucoup de talent, l'éveil de cette Psyché qui sommeille chez tant d'autres et qui chez eux frissonne au contact de la nature et des humaines tendresses.
Dès lors, une synthèse s'élabore avec lenteur, adaptant tous les éléments lyriques de l'âme, comme un orchestre se prépare en le préliminaire tâtonnement des instruments multiples, afin de pousser un « chant .symphonique » où collaboreront toutes les voix. Quand l'humanité tout entière tressaille, le Divin n'est plus loin. J'entends déjà l'écho de ses pas invisibles, ou plutôt il est là, au cœur même de cette humanité rassemblée, car il n'est que l'humain plus humain. Nous pouvons donc saluer dans la poésie son entrée, timide d'abord, bientôt triomphale. Au lieu d'être séparé de nos émotions habituelles, comme on le croyait par erreur, il leur est incorporé.
« Nouveauté surprenante ! t'écries-tu. Depuis que je commence à prendre conscience, j'ai senti s'écrouler la vieille incompatibilité entre le Divin et l'humanité. Combien de fois les a-t-on opposés dans le passé l'un à l'autre ! et cette fausse antinomie a eu pour résultat de retarder indéfiniment le triomphe de l'humanité. Voilà dans les idées une révolution qui équivaut à la conquête de l'air dans le monde physique. C'est, en effet, par l'homme lui-même, « la conquête du ciel ». Michelet a écrit : « La Terre est dans le Ciel » ; l'homme s'y trouve aussi. Dans le ciel métaphysique. Il n'y aspire pas seulement, il y respire. « La nature est surnaturelle » disait Elisabeth Browning, nous pouvons ajouter : « L'homme est surhumain. »
Ton jeune enthousiasme me réchauffe ; n'oublie pas, cependant, qu'il ne s'agit que d'une renaissance ; car le plus pur esprit classique a déjà fixé dans l'art les traits immortels de l'Humanité divine. Et cela avec une simplicité et un naturel inégalés jusqu'ici.
Il n'est pas en effet d'autre formule pour résumer les créations de l'antique Hellas.
Humanité divine, les personnages d'Homère, d'Eschyle, de Sophocle ; humanité divine, les statues de Phidias ; et, jusque dans les lignes du Parthénon, à cause de leur beauté vraie, simple et grandiose, humanité divine ! Nous ne sortons pas de la nature ; le christianisme n'a pas encore, en le martyre volontaire du Juste, imposé sa loi suprême de mystère et d'amour. Et déjà pourtant sur l'Acropole s'accomplit la révélation du Beau, en attendant que plus tard, sur le Golgotha, s'achève la révélation du Vrai. Le salut terrestre de l'artiste est préparé par la Vierge Athéné. Celui en qui habite l'eurythmie ne mourra pas parmi les hommes ; son œuvre est rachetée de l'oubli.
Tu te rappelles la Prière sur l'Acropole, où la séduisante parure du verbe déguise souvent le sophisme et l'erreur. Je ne veux pas ici discuter avec l'ombre de Renan ; mais il est certain que l'idéal hellénique fut plus large qu'il ne le supposa. La beauté qui plaît à la Déesse n'est pas exclusive de certaines beautés. Qu'elles viennent de l'Asie ou de l'Afrique, qu'elles soient la poésie du « Strymon glacé » ou celle qu'on trouve dans « l'ivresse du Thrace », elles se disciplinent et s'épurent sous le regard de Pallas, en s'approchant du seuil sacré. Sans perdre leur caractère propre, elles sont agréées après avoir reçu une commune initiation. C'est ainsi que l'architecture persane et hindoue atteignit son épanouissement absolu à Lahore avec ce tombeau d'une Bégun, appelé le « Tag » et qui est le Parthénon de l'Inde. Là, j'avais déjà compris par l'exemple que cette Pallas-Athéné, depuis qu'elle n'existe plus sous la forme d'une idole visible, est vivante partout où les hommes rêvent de la Beauté parfaite et tentent de lui donner un abri.
On a voulu que l'enseignement du Parthénon fût sectaire. Il n'en est rien. Qui a gravi l'escalier de marbre des Propylées comprend qu'il est le pèlerin du temple où la perfection existe, et où elle est communiquée à chacun selon son aspiration et ses mérites. Là, toute beauté étrangère et nationale trouve sa mesure. Ces débris sublimes accueillent toutes les prières et se prêtent à toutes les méditations; mais leur poussière ne supporte pas l'empreinte des monstres difformes, et la pure lumière qui les baigne dissipe tous les cauchemars de l'ombre.
Le fantôme vivant de l'Humanité divine m'a tellement hanté sur l'Acropole que, corrigeant les épreuves de ce livre à l'ombre de la colonnade sacrée, rompue par l'obus vénitien, j'ai cru recevoir l'ordre de t'adresser ce message, à toi dont le devoir sera de reconstituer le Parthénon dans ton cœur. La voix de la Déesse, qui, là, est plus pressante, m'ordonnait de réveiller dans l'âme des jeunes Français son souvenir, qu'ont obscurci les barbares. Elle me disait :
« L'humanité marche, sans se lasser, vers des buts mystérieux, sur une route semée de tombeaux. Il est inutile de recommencer le passé. Ceux qui me copient ne sont, en effet, que des copistes; ceux qui m'ont imitée ne sont encore que des imitateurs ; seuls, ils me comprennent et m'obéissent, ceux qui me retrouvent. Je suis là où règne l'harmonie ; et seul il est harmonieux celui qui réconcilie en soi la terre et le ciel, l'idéal et la vie, l'humain et le divin, le passé et l'avenir par l'action et par l'œuvre... La mission des peuples que baigne le lac méditerranéen n'est pas terminée : je m'intéresse à eux toujours... »
Parfois, cependant, je sentais l'état de grâce m'abandonner. Devant le vil égoïsme, le culte de l'argent, la suprématie de tout ce qui est mécanique et utile, devant la laideur qui nous assiège de toutes parts, je me demandais si je ne rêvais pas tout éveillé et si le reste du monde n'était pas irrémédiablement perdu. J'étais là sur l'Acropole, comme sur un îlot sacré. Ce paysage de l'Attique ne serait-il pas la concession suprême faite par l'univers à notre idéal ? La mer, comme un lac, toute blanche ou toute rose, sous la caresse du soleil ; les îles paradisiaques ; l'Hymette se dressant contre l'approche du soir, pareille à une épaule protectrice aux frissons nuancés ; Athènes, charmante, gaie et neuve, symbole des recommencements victorieux de la mort, bruissant comme une claire ruche humaine autour du vieux roc noirci et crevassé ; ces ruines autour de moi, plus belles que tant de palais et tant de temples intacts ; ce décor façonné, semble-t-il, par un Dieu artiste qui n'a pas voulu se laisser surpasser par le génie humain, tout cela n'était-il pas l'exception magnifique ? Et au-delà de ces purs horizons où s'arrête mon regard, n'est-ce point, hélas ! que recommencent le désordre et la barbarie ?
Une jeune Américaine montait chaque jour presque à la même heure à l'Acropole. C'était aussi vers le soir. Après un regard de piété au temple exigu et fier de la Victoire Ailée, et surtout à ces jeunes filles de l'Erektéion qui portent leur fardeau de marbre avec l'allégresse des héros qui soulèvent leur destin, elle s'asseyait non loin de moi, sous le divin fronton que sculpta Phidias. Et elle avait un livre... Nous devions lier connaissance, comme il arrive aux fidèles du même culte dans l'église qu'ils fréquentent. Quoiqu'elle fût belle et d'allures libres, le lieu était trop sacré pour que nous pensions à autre chose qu'à lui...
« Chaque année, me dit-elle, je viens ici pour une cure de perfectionnement intérieur. Je suis sinon Athénienne, du moins "Athénéenne". Nous sommes plus nombreux qu'on ne pense, hommes ou femmes, à qui, en Amérique, l'idéal hellénique sert de flambeau. Il ne suffit pas de "faire beaucoup d'argent", il faut "faire du bonheur, de la beauté et de la force". »
Et comme je lui demandais quel livre elle lisait :
« Aujourd'hui, continua-t-elle, j'ai porté un ouvrage d'Emerson. Il est encore notre plus grand philosophe.
Son enseignement est d'accord avec celui du Parthénon. En toutes les existences, même les plus humbles, il découvre un parfum sublime, qu'il s'agisse de l'ouvrier, du laboureur, de l'artiste, du boursier ou du commerçant... Avec des termes qu'une rude franchise rend plus saisissants, il nous initie à ces mystères du sanctuaire psychologique, transfigurant notre personnalité quotidienne et lui communiquant une valeur imprévue.
« L'homme qui mange, boit, plante, a écrit Emerson, ce n'est pas lui que nous respectons, mais l'âme dont il est l'organe ; quand elle passe à travers son intelligence, elle devient génie ; à travers sa volonté, vertu ; quand elle coule à travers ses affections, amour. »
Levant ses beaux yeux clairs vers mon inquiétude, elle ajouta :
« Il n'y a donc pour ce moraliste — et je suis prête à le croire — ni génie, ni vertu, ni amour — et, ajouterai-je, ni chef-d'œuvre — sans le contact de cette étincelle qui illumine le plus obscur. Tout acte héroïque, bonté ou beauté, est un miracle de cette force inconnue qui se manifeste par l'homme, mais qui vient de plus loin. »
Réconforté par ce langage, je demandai à ma vaillante camarade de m'accompagner dans le petit musée de l'Acropole, qui contient des joyaux de sculpture incomparables. Par un hasard que les circonstances semblèrent avoir prémédité, je retrouvai là un jeune poète qui n'est pas ton ami et qui, suivant une mode déjà périmée, se flatte d'être nietzschéen. Il trouvait fade la grâce guerrière de Pallas : « Le moderne surhumain, me dit-il, danse comme un corybante, et son rire de mépris ressemble au rugissement du fauve. » Justement nous étions arrêtés dans la première salle du petit musée, à gauche, devant ce Typhon sardonique à trois têtes et qui a l'air de sauter encore sur les replis tortueux de son corps de dragon. « Cet antique symbole discordant, contradictoire et ricaneur, observa la lectrice d'Emerson, on peut le comparer à l'ennemi toujours renaissant de la sagesse et de la beauté athéniennes, au barbare et au monstre qui prétend à la supériorité, quand il n'atteint que la bizarrerie et la démence. "Uebermensch" venu d'Allemagne, forgé de pièces et de morceaux disparates, difforme, brutal, blasphémateur, cauchemar d'un cerveau génial et malade, te voilà préfiguré à l'aurore des temps ! Tu es le contraire de l'Humanité divine, du héros que Pallas-Athéné modela. Tu n'es pas surhumain, tu es anti-humain ; tu n'as reçu de la Divinité que le reflet défiguré, l'ombre grimaçante, divisée et diabolique.
« Tu ne nous feras pas croire que l'humanité supérieure doit être cruelle et despotique, alors que Pallas nous la montre avec les traits de la paix sous les armes et pareille à l'ordre qui persuade. Notre surhomme saura réunir en lui les deux forces de l'avenir : celle de l'homme et celle de la femme ; il sera mâle et doux comme cette vierge qui porte une lance... »
V
De retour en France, je n'ai pas oublié la voix de l'Acropole. Une véritable recrudescence d'inspirations se manifestait chez nous. J'en ai senti au cœur toute l'allégresse. S'agit-il d'un renouveau classique ? « Classicisme, romantisme », vieux mots, vieilles querelles. Il est bon de se rappeler la parole d'un poète, né en Hellade et qui vécut au Quartier Latin. Au moment de rendre son dernier souffle, il confia à un ami ; « Classicisme, romantisme, tout ça, ce sont des bêtises. » Le conflit qui divisa nos ancêtres est aujourd'hui élucidé. Et voici la nouvelle formule qui concilie les contraires apparents : « Des idées nobles et vivantes dans une forme pure. » Quant à être classique, dans le vieux sens du mot, c'est inutile et impossible.
Quel que soit notre effort, nous n'atteindrons jamais en ce siècle la sérénité dont témoignent encore les ruines immortelles de l'Acropole. Les plus belles œuvres resteront incomplètes et frémissantes.
Il nous faut les chocs douloureux du monde extérieur ou l'épuration du recueillement, pour que se manifeste le magnifique Attendu.
Les conditions de cette révélation singulière sont difficiles et complexes. Si la méditation et la solitude sont nécessaires, les vertiges et les secousses de la passion y contribuent aussi. Les heures de bonheur comme celles de la détresse, l'amour comme la chasteté, les maladies comme la plénitude de la santé, les errances à travers l'univers comme la silencieuse et immobile étude, l'ivresse de la vie comme l'attirance vers la mort, tout ce qui nous emporte et nous arrache de la terre et de la chair après nous en avoir donné la cruelle expérience, voilà comment nous parvenons à nous confronter avec une image de nous-mêmes, qui est nous encore, tout en étant plus lointaine et plus haute. Nous avons perdu la sérénité hellénique, mais nous n'échapperons pas pour cela au Divin. Nous en sommes comme traqués et le remords autant que l'enthousiasme en est l'indice. Un trésor caché en nous bondit et se répand au dehors, à travers les larmes et l'espérance.
VI
Une salutaire crise, qui a épuré, spiritualisé notre psychologie et notre philosophie, nous permet de croire que nos élans lyriques, d'accord avec les orientations de la pensée, ne se perdront pas dans un rapide oubli. Nous sommes en harmonie avec l'esprit du temps.
Les intelligences et les volontés furent longtemps gouvernées par le scientisme matérialiste ou le scepticisme dilettante. Un grand découragement avait été la conséquence de ces deux doctrines, un abaissement des caractères et un affaiblissement de l'idéal. Le Dieu intime s'était voilé, puisqu'on refusait de le reconnaître. Dès cette douloureuse époque, nous fûmes quelques-uns à lutter pour défendre les prérogatives de l'âme, malgré l'enseignement officiel et officieux. Les études concernant la subconscience et les faits mystérieux dont elle est le théâtre, — depuis 1890 nous n'avons cessé d'y apporter notre modeste, mais ardente contribution, — ont préparé l'éclosion d'une philosophie plus aérée et d'une psychologie plus perspicace. Et maintenant commence à triompher notre plus cher idéal. M. Alfred Croiset n'a-t-il pas, en Sorbonne, récemment fait allusion à « des courants nouveaux dans le monde de la pensée » ? M. Emile Boutroux et M. Bergson ont rendu une part de leur valeur méconnue à l'intuition, aux pressentiments et aux forces divinatoires cachées sous les voiles de l'âme profonde. Une ère nouvelle, que nous saluons avec d'autant plus de joie que nous l'avons appelée par nos travaux et nos espoirs, est déjà inaugurée. Qu'est-ce que ces facultés que le rationalisme étouffait ou dédaignait, sinon l'inspiration et le courage, la poésie et l'action ? La France qui pense et qui veut n'est plus ligotée par les mauvais enchanteurs d'autrefois qui tarissaient, en la décriant, la sève du génie et de la victoire ; car la même énergie sert à cette double fin.
S'il existe encore un mysticisme s'opposant à la nature et à la vie, le sentiment qui pénètre ce livre loin de contrarier les élans, les active, feu interne par lequel l'âme devient le véritable buisson ardent. Notre mysticisme à nous fait partie de la vie, c'est même la vie à sa source et dans sa pureté neigeuse et brûlante, — volcan sous un glacier.
Secouée par des émotions profondes, l'humanité sent bien qu'elle sort d'elle-même ; ou plutôt que d'elle-même sort le divin. L'extase et le transport sont des mots et des mouvements que nous ne pouvons reléguer aux manuels des églises ou dans l'ombre pieuse des cloîtres ; ils appartiennent à la langue et aux rites de cette religion universelle, dont le culte illumine et entraîne tous les cœurs dans les moments suprêmes de la vie.
Que nous puissions désormais être appelés des platoniciens d'hier ou des pragmatistes de demain, peu importe : sous des noms différents, des doctrines similaires à de longs intervalles de temps se manifestent. William James est le fils spirituel d'Emerson, qui à son tour puisa dans la sagesse orientale. En tout cas, pas plus que moi, tu ne doutes de l'identité entre la force qui nous inspire et la force qui nous pousse à combattre. Le même dieu intérieur qui dicte aux Homérides leur poème, gonfle de fureur le cœur d'Achille et rend subtil Odysseus. L'humanité divine n'a-t-elle pas réuni, — en le jeune Sophocle combattant à Salamine ou en Byron allant mourir à Missolonghi, — le poète et le héros ?
Celui qui a été touché, même indigne, par la flamme qu'alluma Prometheus, ne peut plus se contenter des tâches égoïstes. Il se donne en activité et en lumière. Il est devenu une torche que le pied même de la mort n'éteindra pas.
Tu le sais mieux que tout autre, telles strophes, écrites çà et là, parmi les chemins de la terre ou de la mer, avec une inquiète ardeur, je ne les aurais jamais ajoutées à ce livre, elles dispersées par le roulis au fumoir des paquebots, ou bien ébauchées sur les tables de ces palais modernes qui ne sont que des palaces, si elles n'avaient le mérite d'être des hymnes de reconnaissance, de célébrer la minute où la personnalité éphémère, terrassée par les circonstances, se relève, appuyée à une main secourable qui est sentie sans être vue... Ces poèmes, qui appartiennent au maître qui me les a inspirés, — il me connaît et je ne le connais pas et j'ai été son disciple trop distrait, — puisque tu m'as fait croire qu'ils t'avaient plu et qu'ils avaient parfois rendu plus sereines les âmes troublées, je les laisserai donc maintenant sous leur robe nouvelle, porter un sourire et un aveu fraternels à des amis ignorés qui, comme nous, ont souffert et ont, malgré tout, repris courage !
Aider et servir par le geste ou par le chant, quel que soit son talent, quelle que soit sa force, telle est la mission des « Prométhéens » ; tel est aussi le devoir de leurs plus humbles disciples. Ceux même d'entre eux à qui ne sourira pas la fortune, ne seront pas pour cela des vaincus. D'autres réaliseront le rêve ébauché. Une immense foi doit habiter en nous, mon ami. Que non seulement elle soit notre raison de vivre, mais encore qu'elle réconforte ceux qui viendront après nous ! Rappelle-toi, dans les meilleures pages de l'Anthologie, cette épitaphe d'un optimisme infrangible, et qu'elle soit notre devise : « Le matelot qui a naufragé sur ce rivage te conseille : Embarque-toi ! Les courants de la mer qui m'ont détruit faisaient naviguer au loin toute une flotte heureuse ! »